|
Si ce message ne s'affiche pas correctement ou si vous désirez imprimer ce numéro, téléchargez la
version pdf
ou contactez-nous.
|

|
||
|
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » |
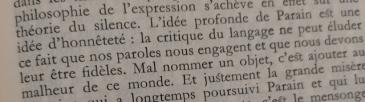
Lors de la cérémonie de clôture du festival de Cannes, la réalisatrice qui s’est vu décerner la palme d’or a fustigé la « marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend » et qui « menace l’exception culturelle française ».
Il est absurde de sous-entendre que les aides publiques dont a bénéficié la réalisation de son film priveraient Mme Justine Triet du droit de critiquer le gouvernement, par exemple à propos de la réforme des retraites. Mais on a tout autant le droit de lui demander si les mots qu’elle emploie sont encore ceux du sens commun. Car enfin, dans quel autre pays un film est-il susceptible d’être réalisé avec plus de 50 % de financement public ? Quel autre pays accorde-t-il aux intermittents du spectacle un régime d’assurance chômage qui les protège contre les aléas de leur activité professionnelle ? Dans quel autre pays, durant la pandémie de Covid, l’absence d’activité des métiers de la culture a-t-elle été compensée comme elle l’a été en France ? Quel autre pays consacre autant de ressources budgétaires – étatiques ou locales – à soutenir le livre, le cinéma, le théâtre, la musique et bien d’autres formes d’expression artistique ? Et est-ce que tout cela ne participe pas de « l’exception culturelle française » ? Mais à dire vrai, peu importe le rapport des mots à la réalité puisque tout est résumé dans le mantra en forme d’excommunication majeure : « le gouvernement néolibéral ». Là aussi, on voudrait demander à tous ceux qui emploient cette expression à quels concepts économiques ils se réfèrent. Dans les années 70, l’adjectif « néolibéral » est venu caractériser les politiques inspirées par l’Ecole de Chicago et mises en œuvre aux Etats-Unis sous Ronald Reagan et au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher, fondées sur la réduction drastique des interventions de l’Etat et la prééminence des règles du marché dans les sphères économiques et sociales. Bien des critiques peuvent être adressées à la politique économique et sociale du président et du gouvernement, ne serait-ce qu’à propos de la réduction des inégalités, de la justice fiscale ou de l’abandon de la promesse de 2017 de lutter contre les rentes. Il n’en reste pas moins qu’il faut se demander si « néolibéral » est l’adjectif qui caractérise le mieux le gouvernement d’un pays qui a l’un des taux de prélèvements obligatoires les plus élevés des pays de l’OCDE, dont les dépenses de protection sociale rapportées au PIB sont également les plus élevées de cette même catégorie, où la politique de redistribution, adossée à la gratuité de nombre de services publics, a un effet d’amortisseur des inégalités qui rapproche notre pays de ceux, souvent cités en exemple, d’Europe du Nord, sans parler du phénomène – certes exceptionnel – du « quoiqu’il en coûte » durant la pandémie de Covid, mais pratiqué à une échelle inégalée des pays industrialisés. Le problème lié à l’emploi pavlovien de l’adjectif « néolibéral » est qu’il dispense de réfléchir, de poser le bon diagnostic et partant, de proposer des solutions alternatives appropriées. Il rappelle d’une certaine manière la situation où se trouvait la pensée économique de la gauche dans les années 50, dominée par la doxa communiste, quand les économistes du Comité central allaient répétant que « la baisse tendancielle des taux de profit » devait inéluctablement provoquer l’effondrement du capitalisme et l’avènement glorieux du prolétariat… La gauche ne s’est sortie de cette impasse idéologique qu'au début des années 60 quand, constatant que la politique mise en œuvre par le régime gaulliste n’était pas réductible aux caricatures et que la modernisation du pays n’était pas intrinsèquement néfaste aux intérêts des couches populaires, des hommes et des femmes venus des clubs, du PSU, du syndicalisme, des intellectuels comme Serge Mallet ou Pierre Naville, se sont réunis pour construire une alternative crédible, reposant sur des réalités et non sur des poncifs, compréhensible par les citoyens et mobilisatrice : ce furent les Rencontres socialistes de Grenoble du printemps 1966, et l’on sait le rôle que Michel Rocard, qui s’appelait encore Georges Servet, y a tenu. N’est-ce pas le même élan qui serait nécessaire aujourd’hui pour que « mal nommer les choses » n’ajoute pas « au malheur du monde » ? |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||||||||

|
Tony Dreyfus |

Par exception, nous publions ce mois-ci un "parcours rocardien" posthume. Mais la place tenue par Tony Dreyfus auprès de Michel Rocard, et durant tant d'années, était telle qu'il nous a semblé impossible de ne pas l'évoquer un peu substantiellement. Sa disparition, le 26 avril dernier, a laissé un vide important dans la galaxie rocardienne. Les quelques lignes qui suivent ne le combleront pas mais nous souhaitons qu'elles permettent à chacune et à chacun de les raccorder aux souvenirs personnels qu'il ou elle garde en mémoire.
Né le 9 janvier 1939, Tony Dreyfus est un enfant de la guerre, même s’il restait très taiseux sur ces premières années. Son père, négociant, était issu de la bourgeoisie havraise et sa mère d'une famille de juifs originaires de Smyrne, d'où ils avaient été chassés par Isabelle la Catholique – « comme Balladur », disait Tony en souriant. Quand l’armée allemande envahit la France, la famille se réfugie à Marseille puis, après 1943, en Corse. Sa mère décède lorsqu’il avait trois ans ; son père, qui l’élèvera, et sa sœur joueront un rôle essentiel dans sa vie.
Étudiant en droit à la fin des années 50, son premier engagement est contre la guerre d’Algérie, dans les rangs de l’UNEF, en 1959 : il en devient vice-président dans l’équipe de Dominique Wallon, en 1961. Officiellement chargé de la communication, il est en fait chargé des contacts avec la préfecture de police pour les manifestations et tient, auprès du président du syndicat comme plus tard auprès de Michel Rocard, le rôle d’homme des missions de confiance et des conseils avisés. Dans le prolongement de l’UNEF, le club Jean-Moulin, puis le PSU où, assez vite, il noue avec Michel Rocard des liens personnels et politiques qui résisteront à toutes les épreuves de la vie. En 1965, il prête serment comme avocat à la Cour d’appel de Paris, et rejoint un cabinet prestigieux, celui de Robert Badinter et de Jean-Denis Bredin. Se voir confier des dossiers relevant du droit de la propriété intellectuelle et de l’édition lui vaut de côtoyer des artistes et des auteurs qui étofferont son carnet d’adresses. Après un passage par le cabinet de Georges Kiejman, il fonde, en 1969, son propre cabinet, avenue Victor Hugo, où il exercera jusqu’à la fin. En avril 1968, il épouse Françoise Fabre-Luce, avocate elle aussi, issue d’une famille apparentée à celle de Valéry Giscard d’Estaing. Bien des années plus tard, Tony évoquait en plaisantant sa première rencontre avec son beau-père, Alfred Fabre-Luce, écrivain et auteur de théâtre à succès dans l’entre-deux-guerres, dont on peut dire que le comportement sous l’Occupation n’avait pas été exempt de tout reproche et qui restait farouchement antigaulliste : « Un avocat, juif et PSU, ça faisait quand même beaucoup pour lui. Enfin, comme le PSU était opposé à De Gaulle, ça compensait un peu le reste… » Les élections législatives de juin 68 constituent sa première expérience électorale dans le 18ème arrondissement de Paris, où il recueille 7,5 % des voix, un score flatteur pour un candidat PSU à cette époque. Les excès gauchistes du PSU des années post-68 ne sont pas exactement sa tasse de thé : « On est chez les fous ! » disait-il souvent en écarquillant les yeux derrière ses lunettes en demi-lunes perchées sur l’avant de son nez. Pour autant, ces années sont aussi celles où Tony Dreyfus, qui sera souvent présenté par la suite comme un avocat d’affaires, se lie avec des dirigeants de la CFDT, notamment Edmond Maire et Jacques Chérèque, alors responsable de la fédération de la métallurgie. Ce sont ces liens qui font de lui un acteur important de l’affaire Lip, en 1973, puisqu’il conçoit l’habillage juridique de la « vente sauvage » des montres saisies par les grévistes et en négocie les termes avec le ministère de la Justice. En 1974, c’est sans états d’âme qu’il suit Michel Rocard au Parti socialiste : c’est d’ailleurs dans les locaux de son cabinet que l’état-major rocardien se réunit pour préparer les Assises du socialisme et l’entrée au PS. Soutenir Rocard dans sa démarche en vue de l’élection présidentielle de 1981 ne l’empêche pas de cultiver de bonnes relations avec certains proches de François Mitterrand comme Georges Dayan ou André Rousselet, dont il restera l'ami. En 1977, il est candidat aux élections municipales à Troyes, contre Robert Galley, maire sortant, ancien ministre et trésorier du parti gaulliste. Il recueille 40 % des suffrages. Ce n’est que dix ans plus tard que Tony Dreyfus choisit de quitter les coulisses de l’action politique pour l’avant-scène. Lui qui eût excellé dans « les fausses confidences » de Marivaux – celles que l’on recueille et celles qu’on distille – et qui conseillait à ses clients de préférer un bon arrangement à un procès, nécessairement mauvais, du moins le plus souvent, ne pouvait pas rester à l’écart des projecteurs lorsque Michel Rocard devint Premier ministre. Il est nommé le 13 mai 1988 secrétaire d’État auprès du Premier ministre et figure dans un premier temps sur la liste du gouvernement comme étant « sans attributions », comme il y avait sous la IVè République des « secrétaires d’État à la Présidence du Conseil ». Rapidement, Michel Rocard et lui conviennent que cette absence d’attributions pouvait devenir problématique. Et comme les dignitaires du secteur de l’économie sociale s’étonnaient auprès du Premier ministre qu’il n’ait désigné personne pour être leur interlocuteur, lui qui avait été en 1981 le premier membre d’un gouvernement en charge de ce secteur, la parade fût vite trouvée : j’attache tellement d’importance à l’économie sociale et solidaire, leur répondit en substance Michel Rocard, que c’est l’un de mes plus proches au sein du gouvernement qui aura la charge de ce secteur. Et c’est ainsi que Tony Dreyfus devint secrétaire d’État chargé de l’économie sociale et solidaire. Il aborde ce « tiers secteur », comme on disait à l’époque, avec circonspection. Cependant, comme l’écrira François Soulage, alors délégué interministériel à l’économie sociale et solidaire, lors de son décès, « son scepticisme face aux grandes réformes dont nous rêvions nous a souvent permis de trouver des solutions réalistes. Avec Tony Dreyfus, nous avons enfin réalisé les promesses préparées dès avant 1981. » Il sera en particulier l’artisan d’une loi permettant aux salariés exerçant des responsabilités dans les associations de bénéficier de congés particuliers pour assurer leur mandat. C’est en tant que membre du gouvernement qu’il se présente en 1989 aux élections municipales à Paris dans le Xe arrondissement. S’il ne parvient pas à déloger le sortant RPR, il est élu au Conseil de Paris et dispose, avec 35,3 % des voix au second tour, d’un solide capital de départ pour un enracinement qu’il va préparer, à sa manière, avec discrétion et méthode. En 1995, il fait basculer le Xe à gauche – avec cinq autres arrondissements de la capitale – dans une élection triangulaire, préparant ainsi la victoire de 2001. Dans ce mandat de maire, Tony Dreyfus donne la pleine mesure de sa façon de concevoir la politique, axée sur le goût du concret et le sens de l’humain. Serviable et généreux, il veille à conserver un lien de proximité avec les électeurs en arpentant le samedi matin les artères de son arrondissement. Durant ses trois mandats de maire, il est aussi l’homme des choix innovants et courageux : la reconquête du canal Saint-Martin, la réhabilitation de l’ancien couvent des Récollets en lieu d’échanges et d’accueil artistiques, la rénovation du cinéma Louxor, chef d'œuvre du style "néo-égyptien" de l'entre-deux-guerres, la transformation de l'ancien hôpital Saint-Lazare en médiathèque Françoise-Sagan ou encore un centre d’accueil pour toxicomanes… En 1997, il est élu député du Xe arrondissement, accomplissant d’une certaine façon le destin que lui avait tracé son père qui, lorsqu’il avait de bons résultats scolaires, l’emmenait soit aux courses à Longchamp ou Auteuil, soit à l’Assemblée nationale. Il a sa vie durant continué à s’intéresser aux courses d’obstacle ou de galop, avait une connaissance encyclopédique des chevaux, de leurs jockeys, de leurs entraîneurs ou de leurs propriétaires, qui était loin d’être récompensée par des gains au tiercé ou sur l’hippodrome. Mais l’adrénaline de la course le motivait, au moins autant que celle de la politique. Alors, pouvoir lire Paris-Turf sur les banquettes de velours de l’Assemblée, quelle consécration ! Il fait également trois mandats de député, siégeant à la commission des finances puis à celle des affaires étrangères, à la Cour de Justice de la République (lors du procès Pasqua) et, en 2009-2010, exerce les fonctions de vice-président de l’Assemblée nationale. Les roulements de tambour et la haie d’honneur de la Garde républicaine qui accompagnent l’arrivée du président de séance au perchoir ne le laissaient pas indifférent – émotion perceptible au détachement apparent avec lequel il en parlait… Au sein de la galaxie socialiste extrêmement clivée de la fédération parisienne du Parti socialiste, Tony Dreyfus est en bons termes avec à peu près tout le monde. Cela lui permet, lors de la campagne de 2001, de jouer un rôle discret mais effectif pour rassembler tout ce petit monde autour de la candidature de Bertrand Delanoë, avec qui il a noué de vraies relations d’amitié. Tout en menant sa propre barque à partir des années 90, Tony Dreyfus est resté d’une fidélité sans faille à Michel Rocard. Une fidélité personnelle, qui s’est accompagnée d’une présence constante et de conseils avisés lorsque la vie familiale complexe de Michel Rocard le nécessitait. Une fidélité politique tout aussi résolue, sans doute parce qu’il voyait en Rocard le successeur naturel de Pierre Mendès France. Michel Rocard a eu beaucoup d’amis politiques très proches qui l’ont accompagné, s’en sont éloignés, puis sont revenus avec le temps qui passe. Tony Dreyfus a toujours répondu présent. De Michel Rocard, il connaissait les défauts mieux que personne – « tu me connais, je suis un poisson froid » disait-il en tirant sur sa pipe – et aucun historien ne pourra jamais établir la liste des déboires qu’il lui a évités, sur le plan personnel comme sur les questions de financement de la vie politique. La mort, en 2013, de Guy Carcassonne qu’il avait accueilli dans son cabinet de l’avenue Victor-Hugo, puis celle de Michel Rocard en 2016 l’avaient profondément affecté. Il lui est resté pour se consoler son épouse Françoise et ses cinq enfants – Pauline, Louis, Julien, Kléber et Henri – dont il était si fier. Il était l’élégance et la fidélité, l’humour et le réalisme, la générosité et l’efficacité : comme il nous manque ! Jean-François MERLE Vice-président délégué de MichelRocard.org Photo : Tony Dreyfus, lors du premier Conseil des ministres du gouvernement Rocard en 1988, aux côtés de Pierre Bérégovoy et de Jacques Chérèque (cliché M & P Guéna-FJJ) |

|

|
||
Le français, langue des droits de l’homme ? |
||

En mars 1998, la direction régionale aux affaires culturelles de Rhône-Alpes avait invité Michel Rocard, dans le cadre d'une opération "Le français comme on l'aime" initiée par le ministère de la Culture et de la Communication, à une conférence-débat sur le thème "Le français, langue des droits de l'homme ?", conférence-débat lors de laquelle était également intervenu Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture et de la Francophonie, à l'origine de la loi de 1994 sur l'emploi de la langue française.
La manifestation lyonnaise avait été réalisée en partenariat avec la Fondation La Poste, dont la déléguée générale Sylvie Pélissier est devenue quelques années plus tard Sylvie Rocard... Une plaquette reprenant l'intervention de Michel Rocard avait été réalisée peu après cette conférence, mais elle était épuisée. Un éditeur de la région Rhône-Alpes, La rumeur libre, vient d'avoir l'excellente idée de rééditer ce beau texte, qui peut être commandé à partir du lien ci-dessous. Nous en publions ci-dessous quelques bonnes feuilles. Le superbe sujet que voilà ! Dès que j’en ai eu connaissance, j’ai bousculé quelques rendez-vous pour pouvoir participer à ce débat. J’aime mon pays, j’aime ma langue maternelle et je suis militant des droits de l’homme. À ce sympathique appel, j’ai répondu présent.
Toutefois, dès l’abord, une observation s’impose. Il n’y a pas de point d’interrogation à la fin de la formule « Le français, langue des droits de l’homme ». Nous ne sommes donc invités qu’à commenter ou illustrer. Le doute n’a pas sa place. Cela me paraît quelque peu dangereux. Pour les francophones invétérés, le fait de parvenir à une certitude sur le point de savoir si le français est bien la langue la plus porteuse ou la plus adéquate pour exprimer le corpus juridique des droits de l’homme n’aboutira qu’à confirmer leur conviction préétablie : belle langue parmi d’autres, le français est en outre paré de vertus qui en font la plus grande langue de civilisation. Mais le renforcement de cette conviction n’apporte rien au rayonnement de la langue chez ceux qui ne la parlent point. L’intérêt majeur de l’affirmation soumise à nos débats, c’est à mon sens d’en convaincre les autres. Mais alors il serait de toute façon courtois, et en outre plutôt sage, d’ouvrir délibérément le doute, de transformer notre sympathique rencontre en un véritable séminaire de réflexion linguistique pour tenter d’apporter une réponse argumentée plutôt qu’acquise d’avance à cette difficile question : le français est-il la langue des droits de l’homme ? Après tout, les droits de l’homme comportent aussi le droit des non-francophones à parler n’importe quelle autre langue. L’objet dont nous traitons, la langue française, a déjà tant de lettres de noblesse que, tout compte fait, nous n’avons guère besoin de rajouter à son sujet de l’arrogance. Ne devrions-nous pas appliquer aux langues l’article premier de la Déclaration de 1789 : les langues naissent et demeurent libres et égales en droits – y compris en droit d’exprimer les droits de l’homme ? C’est dans cet esprit que je vais tenter d’apporter mes esquisses personnelles de réponses aux trois questions que ce débat implique :
Je traiterai ces questions avec sans doute une inégale pertinence. Pour le passé, je suis peu historien. Pour le présent, je suis parfaitement étranger à cette grande discipline qu’est la linguistique. En revanche, pour l’avenir, je me fais quelque idée des chocs technologiques et géopolitiques que nous allons connaître. (…) Reste le grand problème. La langue est belle, elle supporte la clarté des concepts. Mais qui nous dit que l’allemand, le russe, l’anglais, l’espagnol, voire l’arabe ou le chinois, n’auraient pas pu être porteurs d’un texte aussi fondateur ? Nous savons d’ailleurs que, par bonheur, cette Déclaration de 1789 a été traduite dans toutes les langues écrites et que l’immense majorité des hommes et des femmes n’en ont pas pris connaissance dans notre langue, mais dans la leur. L’histoire a tranché, en fait, et beaucoup plus que la langue. La part de chance historique qui a fait du français une des premières, sinon la plus grande, langue des droits de l’homme est à l’évidence considérable, et nous rappelle par conséquent à une certaine humilité linguistique sinon historique. Ce n’est en effet pas la première langue à évoquer les droits de l’homme ; il est clair que les Anglo-Saxons nous avaient devancés sur certains de ces concepts. Mais c’est dans notre langue qu’a été proclamée pour la première fois une déclaration solennelle de ces droits imprescriptibles que d’autres avaient su reconnaître et nommer avant nous. L’équité nous crée toutefois sur ce point un devoir de comparaison historique. On sait que, dans l’écriture du droit public, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, que n’annonçait réellement aucun document public préalable dans les décennies précédentes. L’Édit de tolérance de 1787 a un champ beaucoup plus restreint. Il n’en va pas de même dans les treize colonies britanniques d’Amérique du Nord. En 1789, cela fait plus de dix ans qu’est en gésine un processus d’accouchement progressif de l’indépendance et de la liberté par séparation d’avec la mère patrie. On constitutionnalise beaucoup. Il y a des préambules de principe dans chacune des constitutions des treize États. Et les États-Unis eux-mêmes, nés d’un traité signé à Paris, sont constitués en 1787. Antériorité ? Seraient-ils les premiers à fonder leurs principes d’organisation sociale sur autre chose que la transcendance ? L’histoire nous fait ici un clin d’œil. Car le Bill of Rights, la « Déclaration des droits », fait d’amendements qui prennent place en tête de la Constitution américaine, est approuvé le 15 décembre 1791. Cocorico ! Nous sommes bien les premiers. Soyons sérieux : le pittoresque hasardeux de la chronologie doit laisser place à un regard attentif, et si possible objectif, sur les textes eux-mêmes. Or, la comparaison est aveuglante. Les deux premiers mots de chaque déclaration disent tout : « les hommes » dans le texte français, « le Congrès » dans le texte américain. Le français se veut universel. L’américain se veut local. Le français définit la liberté dans son principe et ses limites. L’américain donne instruction aux pouvoirs publics de respecter les libertés de religion, d’opinion ou de presse. Le français fonde la légitimité des pouvoirs publics et de la loi. L’américain se limite à garantir les libertés et les droits des citoyens, surtout en matière de justice, face aux pouvoirs publics dont l’existence est acquise par ailleurs. Cela cependant ne règle pas tout. Il est historiquement établi que les préambules et les textes des premières constitutions américaines, celle de Virginie notamment, circulaient en France. Marcel Thomann écrit que la consigne de suivre la pratique américaine avait été transmise à la plupart des députés du Tiers État. Quelques avant-projets de la Déclaration française sont même intégralement recopiés sur des textes américains. Et Rabaut Saint-Étienne put s’écrier à l’Assemblée en train de devenir constituante, le 17 août 1789, sans être le moins du monde contredit : « Vous avez adopté le parti de la Déclaration des droits parce que vos cahiers [de doléances] vous imposent de le faire, et vos cahiers vous en ont parlé parce que la France a eu pour exemple l’Amérique ». Au total, il reste tout de même que la Déclaration française est de portée infiniment plus générale. C’est elle qui constitue le grand texte mondial et cela explique dès lors son évidente parenté avec la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 ; les Nations-Unies de l’époque étaient si conscientes de cette autorité intellectuelle dans l’antériorité qu’elles avaient confié au Français René Cassin la tâche d’écrire l’avant-projet de Déclaration universelle qui ne fut bien sûr adopté qu’une fois traduit dans toutes les langues de travail des Nations-Unies. Les Américains ont écrit pour eux- mêmes et les Français pour le monde. (…)
|
||

|
|
||||
| Convictions est édité par l'Association MichelRocard.org. Directeur de la publication : Pierre Pringuet. Conception, réalisation et routage : APHANIA. Copyright : MichelRocard.org. Tous droits réservés. Conformément à la loi 2004-801 du 6 août 2004, modifiant la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous à Association MichelRocard.org (12 Cité Malesherbes - 75009 Paris) ou écrivez à contact-asso-michelrocard@alyas.aphania.com |